 Pierre Verlhac est né en 1868 à Souillac. Il est mort aux Quatres-routes en 1955.
Pierre Verlhac est né en 1868 à Souillac. Il est mort aux Quatres-routes en 1955.
Il fit une carrière d’instituteur. Laïque, ami de Louis-Jean Malvy, Pierre Verlhac militait en faveur des exclus et de la langue d’oc. Il a été l’animateur de la section de Souillac de la ligue des droits de l’homme, et s’est engagé en faveur des républicains espagnols.
Il était aussi un musicien populaire, un fin conteur occitan, un auteur de poèmes et de chansons. Signalons également qu’il fut un des premiers à militer pour l’enseignement de l’occitan.
A lire l’article qui lui est consacré par Gaston Bazalgues dans la revue QUERCY RECHERCHE dans son numéro 96.
Tous les textes et poèmes ci-dessous sont reproduits par Quercy Net, avec l’autorisation de la famille de Pierre Verlhac ©
T’aïmi Soulhac (chanson sur l’air de « Charme d’amour »)
T’aïmi Soulhac, polida vila,
Pincada sus un pitchou riu,
Acocolada dins ton niu,
Ont la vida i es bien tranquila,
T’aïmi Soulhac, polida vila.
Es rescondut dinsun trauquet,
Oval, tout pres de la riviera,
Que faï bronzit son fin orquet,
En lo bressen l’annada entiera,
Coma un nene dins sa brassiera.
Quand lo solelh sus el lusit,
Sus sa companha bravonela
Que cosqueletga e resolit
Mon vielh Soulhac sembla una estela
Es escompat dins de dentela.
Contaria pas per ma vilota
Mai me donesson tout Paris
Per que la trova trop bravota
e qu’ai l’amor de mon païs
Contaria pas per va vilota.
Dins mon Soulhac ieu restarai
Fier s’aqui ma vida s’engruna
Lo servirai, lo contarai
Que sera tota ma fortuna
T’aïmi Soulhac, o ma comuna !
 La lampe (écrit en décembre 1938)
La lampe (écrit en décembre 1938)
L’ennui tombe sur moi comme un lourd crépuscule.
Ma chambre est pleine d’ombre et mon coeur est désert.
Espoirs, regrets, désirs, tout est mort ! et dans l’air,
Je ne sais quoi de morne et de glacé circule.
Mon âme, où tout le deuil des choses s’accumule,
Tremble devant le soir, d’un grand frisson amer.
L’horizon a sombré dans la brume d’hiver.
On dirait que la vie, incertaine recule.
Je vais mettre très haut ma lampe et ma pensée,
Pour que, si quelque ami, passant sur la chaussée,
Vers mon humble logis vient à lever les yeux,
Ou bien si quelque rêve égaré dans les cieux,
Cherche, pour s’y poser, une âme triste et tendre,
L’ami songe à monter, et le rêve à descendre.
Mon front trop lourd s’incline et je suis las d’attendre.
Voici que le jour point ; ma lampe va mourir.
Ils ne sont pas venus, ceux qui devaient venir.
Josepon e l’Emperur
Josepon e l’emperur est une histoire de fin de banquet sans prétention. C’est l’histoire d’un souillagais qui lors de son service militaire rencontre l’empereur Louis Bonaparte, mais le héros n’est pas celui qu’on croit. Ce texte décrit bien une époque où les quercinois parlent mieux l’occitan que le français.
Josepon Bernotel fasia son servici al 78ème quand, un matin, una novèla recruda arribèt à l’escoada.
Josepon, assetat sus son bas-flanc, fumava una vièlha pipa culotada quand lo novèl blu s’aprochèt, li demandèt del fèc e s’assetèt a costat de guel.
– Comment t’appelles-tu ?
– Josepon Bernotel.
– Tu parles français ?
– Je le comprenne mais pour le parladis j’étions plus fort en patois.
– D’où es-tu ?
– De Souillac.
– Où celà se trouve-t-il ?
– Tu n’en connes pas ta jographie, ni mai ieu tanpauc. Tu ne saves pas où se trouve Souillac, la plus poulide ville du Lot où res manque, mila Dius ?
– Si c’est dans le Lot, je vois.
– Et toi caman que tu t’appelles ?
– Louis Bonaparte.
– Quoi que tu fais dans le civil ? Tu n’as pas une place ?
– Oui, pas trop mal.
– Eh bé tope aqui Bonatrappe. Tu déves savre lisir, tu m’apprendra à lisir un peu.
– C’est entendu et toi tu m’apprendras ta belle langue patoise (qui de l’avis de Charles Nodier développe tant de noblesse et d’imagination.
– Je n’enconné pas tous ces bestials mais pel potois tè: diga-li que vengue mila Dius !
Louis Bonaparte aprenguèt perfectament lo potois mas Bernotel poguèt pas aprene a legir. Tot parièr, fasquèron un brave parelh d’amics.
Bernotel, son temps acabat, torna a Solhac. Tres ans après, lo portur li porta una letra. Josepon la vira e la revira entre sos dets.
– Tè factur, legis-me aquela letra. Lo factur la duèrp, la legis e ne’n tira un bilhet de cinq cents francs.
– Bogre, quo’s l’Emperur que t’escriu e t’espèra dissabte a detz oras.
– L’Emperur, mila Dius, e qué me vol aquel ome ? Pagui regulieroment ma talha, n’ai jamai fach de mal a degun, mos certificats al regiment portan: bon soldat, bonne conduite… Qué diable me vol aquel ome ?
Josepon, la letra a la man, vai trovar lo mèra.
– Digatz-me, monsur lo mèra, qué me vol l’Emperur ?
– E mon brave Josepon, del moment que t’envoia los sous pel viatge, te cal i anar, veiras aital de qué te vol.
Mon Josepon part per Paris. A detz oras se presenta a las Tuilarias. Es arrestat a la porta per un oficièr que li demanda ço que vol.
– Vèni veire l’Emperur, pardi !
– Avez-vous une lettre d’audience ?
– De qué, nom d’un Diu, n’ai pas de letra de dança mai l’Emperur m’a mandat venir. Tenètz, legissètz aquel papieron.
L’oficièr legis e saluda. Josepon dintra, agacha de tots pans e, a una fenèstra, te guèita Louis Bonaparte.
– O ! per mon arma ! A ! pr’exemple, quo’s un pauc fort, es aqui mon vièlh Louis, o ! lo diable me flambe ne’n soi tot estomagat, davala un psuc, me foras veire ont cal passar.
Un autre oficièr, tot cambaligat d’or, ven prene Josepon e lo mena davant Bonaparte. Louis e guel s’embraçan coma pan tendre.
– Mai diga-donc Louis, ès dins un polit ostal ! Tu tanben ès vengut veire l’Emperur ? As una bona plaça ? Qué fas ?
– Que soi content de te veire Bernotel e de parlar un brieu lo potois que m’as après.
– Es maridat Louis ?
– Oui.
– Coma s’apela ta femna ?
– Eugénie.
– Génie quo’s un polit nom. Es qué as deus mainatges ?
– Oui, un drolle.
– N’a màs un troç de gaulem ? Me faras pas veire ta femna ?
– Si, mai es pas levada encara.
– Es pas levada ! Qual troç de fenhanta ! E la daissas far ? E ben, mon vièlh, li te brandiria las negras ieu !
L’emperur risia, risia, risia de bon cur.
– Quo te fai rire aquo. La nostra se lèva a poncha d’auba e d’aquesta ora a bacat los tessons, mozut las vacas e estremat la bugada. Podes pas la degordir un pauc nom d’un Diu !
An aquel moment, I’lmperatriça intrigada peus escluts de rire de l’Emperur, alors qu’aquel d’aqui èra totjorn triste, dintra ambe lo pichon mainatjon.
– Quo’s Génie aquela ?
– Oui.
– Compren lo potois ?
– Non.
– Tant pis ! Bonjour Génie comme ça va ? Oh que votre drolle il est mindiou, il est brave mais qu’il est prin: c’est un regoutsioulou: il faudra me le donner, je le d’emporterai à Souillac et quand il tournera, il aura des galojes comme s’il avait les gotages. II faut que je le poutoune ce drolle. Tenez Génie véqui deux sous pour lui cromper un croque-lin.
L’lmperatriça es aurida. L’Emperur ritz a se’n téner las costas.
– Mai diga-donc Louis, quo’s pas tot aquo, quo’s pro parlufejar, I’Emperur m’a escrich de venir lo veire. Se Io conneisses, mena-me près de guel. Tè, agacha sa letra. Qué diable me voI ?
– Mon amic Bernotel, I’Emperur volia te veire per serra la man d’un brave ome. Quo i arriba pas trop sovent. Quo’s ieu que soi l’Emperur.
– Ane, ane, fasque pas lo nèci, bogre de falordas vos està suau.
– Mai te disi que quo’s ieu l’Emperur.
– C’est varté Génie ?
– Oui.
– E ben mon tesson, en parlent per respect, escusa-me, ne’n soi tot embluat. Me racontas pas de porrimelas benleu ? E ben que lo diable me crame, podètz o dire qu’avètz una brava plaça. Coquin de Diu, I’estonament me copa l’alen, bufi coma un cordaire.
Mai parlem que valgue. Soi content de t’aver vist mai me tarda d’esprandir, soi tot escafornit. I a pas moien de far chabrot ?
 Cette rubrique réalisée, il y a quelques années par Claude Lufeaux, avec le concours de l’Association de Recherche sur l’Histoire des Familles ARHFA est en cours de mise à jour.
Cette rubrique réalisée, il y a quelques années par Claude Lufeaux, avec le concours de l’Association de Recherche sur l’Histoire des Familles ARHFA est en cours de mise à jour.







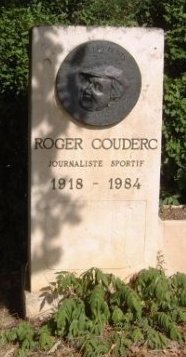





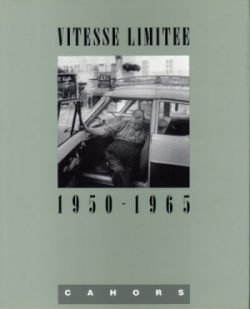
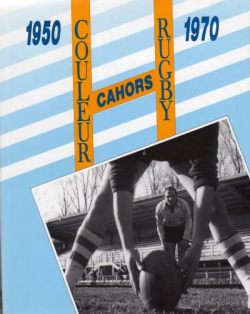











 Pour 1 kg de citrouille cuite à l’eau et écrasée à la fourchette,
Pour 1 kg de citrouille cuite à l’eau et écrasée à la fourchette,



