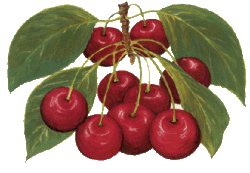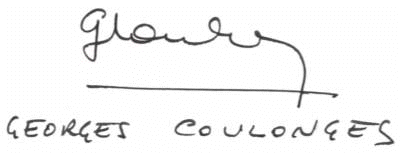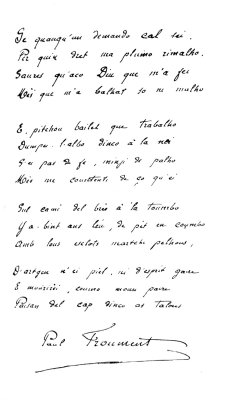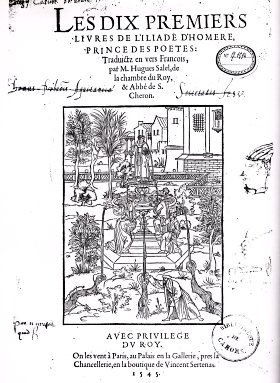Un enfant du village ?
Marc, le fils de l’Antoinette, était, selon l’expression usuelle » du village » et personne ne lui contestait cette appartenance. Né après la guerre, ses parents l’avaient envoyé contre son gré faire des études à Toulouse. Il était devenu un citadin qui vivait toute la semaine dans cette ville ou il exerçait un métier d’ingénieur correctement payé. Adulte il reconnaissait leur mérite car, par leur fermeté mais aussi leur sacrifice, ils lui avaient permis d’accéder à ce statut.
Il avait conservé cependant un profond attachement à la terre et à son village dont il avait été frustré durant sa jeunesse. Pour ces raisons et aussi par égard pour ses parents devenus vieux, il y avait restauré, dés les débuts de sa vie professionnelle, une maison qu’il rejoignait avec sa famille toutes les fins de semaine. Néanmoins, ses voisins au village, tout en lui gardant amitié et parfois un peu d’envie pour sa relative réussite, manifestaient une certaine distance. Il était devenu un autre et elle se traduisait par des détails de comportement comme le fait de refuser de parler patois avec lui ou d’éviter en sa présence certains sujets qui concernaient la vie de la communauté.
Les champignons sont sortis.
 Depuis quelques jours les premiers champignons avaient fait leur apparition au marché de Cahors. Dans les villages de Boissières, Calamane, Nuzéjouls, Uzech et alentours le bruit courait, en ce début juin, les amis ne se saluaient plus que par » ils sont sortis, irez-vous ? « .
Depuis quelques jours les premiers champignons avaient fait leur apparition au marché de Cahors. Dans les villages de Boissières, Calamane, Nuzéjouls, Uzech et alentours le bruit courait, en ce début juin, les amis ne se saluaient plus que par » ils sont sortis, irez-vous ? « .
Le père Léon, comme tous les ans, avait anticipé la rumeur et commencé une abondante cueillette dés le mercredi matin, premier jour de la vieille lune. Aussi en ce samedi décida-t-il d’aller à nouveau parcourir les bois de châtaigniers, avec sa canne et son panier mais sans conviction. Agriculteur-retraité depuis peu il était libre de son temps.
Il aimait marcher en prenant le temps de retrouver les champs, les bois ou les prés quelle que soit la saison. En fait, il aimait la terre, sa terre et s’émerveillait de ses différentes transformations d’une saison à l’autre ou au cours des années. Quand il était plus jeune, il aimait la fouler pieds nus ou s’y étendre pour la sieste l’été, ce qui désespérait sa femme qui redoutait un refroidissement.
Tout en marchant il évoqua un moment son souvenir, la seule grande aventure de sa vie: Il regretta de s’être décidé à lui » parler » alors qu’ils étaient déjà trop vieux pour avoir des enfants. Lors de sa disparition brutale, elle l’avait laissé seul avec un chat commun auquel il n’avait jamais fait attention de son vivant. Il s’y était attaché depuis comme un rescapé s’accroche à un objet qui lui rappelle une catastrophe, un désastre.
Depuis son veuvage, il y a quelques années, ces pensées lui revenaient souvent et il les chassait avec un mouvement d’humeur que trahissait une ombre fugitive passant sur son visage.
Léon rencontre Marc.
Il avançait dans le bois sans chercher, écoutant et respirant pour le plaisir. Au-dessus de sa tête, un chêne, couché par la dernière tempête, étreignait son voisin et le vent qui agitait les cimes le faisait gémir d’une plainte presque humaine. Attentif à ne rien déranger au sol des herbes ou des ronces, il évitait de marcher sur la terre meuble ou fraîche, là où les taupes viennent respirer par exemple, afin que rien ne trahisse son passage et sa destination vers ses » coins « . Il était jaloux de ceux-ci et s’immobilisait chaque fois qu’il voyait venir vers lui un autre cueilleur, le laissant passer en se dissimulant derrière un arbre. La première fois qu’il vit Marc, la colère l’envahit une fois de plus contre ces étrangers qui n’ont aucun droit de cueillette et ne respectent pas la propriété privée.
Il l’observa un moment cherchant à le reconnaître sans y parvenir. Visiblement le jeune homme ne connaissait rien aux champignons et comme, de mémoire d’homme, au village, on n’avait jamais rien trouvé là où il cherchait, il le jugea inoffensif. Calmé, il l’observa avec amusement et le vit fouiller sous les fougères qu’il écartait avec précaution du bout de son bâton. Son sourire condescendant se figea lorsqu’il le vit se baisser et ramasser ce qui lui parût être un petit cèpe brun et luisant au chapeau rond et frais.
Ne pouvant résister à la curiosité, il s’approcha sans précaution, faisant semblant de chercher lui aussi. Arrivé à proximité il le salua en cherchant à voir le contenu de son panier. Dans celui-ci il reconnut une petite bouteille de bière vide et maculée de la terre fraîche d’où Marc l’avait extraite. » C’est là toute votre récolte ? » s’enquit-il mi-amusé mi-narquois. Le jeune homme reconnut effectivement que c’était bien là tout ce qu’il avait trouvé mais que ce faisant, il voulait contribuer à l’écologie de la planète. En le félicitant Léon se dit que tant que les girolles ou les cèpes ne clignoteraient pas comme l’ambulance, cet écologiste ne ferait pas de mal à ses champignons. Soudain à force de le dévisager, il sût qui il était tant les traits du jeune homme lui rappelaient Antoinette.
Léon commence à délirer « grave ».
L’été qui suivit passa sans que Léon rencontre Marc au village. Ce dernier avait profité de ses congés dans un de ces lieux ou les citadins ont l’habitude de se retrouver et s’entasser. Depuis cette première rencontre, les pensées de Léon revenaient souvent vers sa jeunesse, la bande de copains des années soixante, il évoquait avec plaisir Antoinette qu’il avait courtisé un été, les autres dont la vie avait dispersé la plupart. Il aimait retrouver dans son souvenir leurs visages. A l’occasion des rencontres au village ou à Cahors, il cherchait à savoir ce qu’ils étaient devenus, s’ils avaient des enfants.
Les cèpes d’automne ramenèrent Léon à ses promenades sylvestres. Il retrouvait les arbres, les odeurs et en jouissait comme s’ils étaient sa propriété exclusive. Il avançait, remuant ses souvenirs lentement, prenant plaisir à les revivre intensément, dans tous les détails, comme un scénariste fait quand il veut réaliser un film. C’est brutalement qu’un matin l’idée s’imposa à lui comme une certitude. Il se mit fébrilement à compter les années depuis cet été ou il avait tellement dansé avec Antoinette que tout le village s’attendait à les marier.
Il fouilla dans sa mémoire le visage de Marc se demandant comment reconnaître son age dans ce souvenir. Il regrettait de l’avoir considéré avec distance et de s’être moqué, de lui avoir fait de la peine peut-être. Il éprouva le besoin de le rencontrer à nouveau. Constamment ses pensées revenaient vers celui qu’il n’appelait plus que » le petit » avec une tendresse quasi paternelle.
Tout dans le présent était prétexte à exhumer un souvenir en essayant de refaire l’histoire de sa vie qui tournait en boucle dans sa pauvre tête d’homme seul face à la vieillesse : Le train de Paris qui, après le viaduc de Calamane, s’engouffrait dans le tunnel de Nuzéjouls, dont il attendait auparavant avec amusement le long sanglot étouffé d’agonie, lui rappelait à présent son départ pour Marseille vers l’Algérie et les adieux d’Antoinette sur le quai de Cahors. Le cri de victoire, qu’il poussait en débouchant sur la vallée de Saint-Denis, le ramenait au présent jusqu’à ce qu’un nouveau détail ne le replonge dans un passé qu’il s’efforçait de retrouver et à partir duquel il recommençait à délirer..
La folie du vieux, le souvenir de sa femme.
Il errait dans les bois toute la journée et au village certains commençaient à se poser des questions sur sa santé mentale. Rentré chez lui il soignait le chat sans le voir et la bête, qui souffrait de cette indifférence injuste, dépérissait.
Un soir, il pensa aux rares photos de cette époque. Il se mit à les rechercher dans le tiroir de l’armoire que sa femme avait réservée à cet usage et ou il n’avait jamais fouillé de son vivant. Il reconnut son goût de l’ordre en découvrant une série d’enveloppes dont chacune contenait une tranche des souvenirs du couple, et sur lesquelles l’écriture calligraphiée de son épouse indiquait l’époque ou l’événement dont le contenu était l’objet.
Au-dessus, trop grande pour entrer dans une enveloppe ou trop chargée d’émotion pour celle qui avait ordonné le contenu du tiroir, était la photo de leur mariage. Jusqu’à ce jour il n’avait jamais pris le temps de regarder longtemps ce qu’il considérait comme des images. Il l’ouvrit et pour la première fois la considéra avec attention, fouillant dans les visages et les attitudes afin de ressusciter les pensées et les sentiments cachés. Il se trouva un air inexpressif et convenu. Sa femme éclatait de joie et de bonheur. L’évocation du souvenir de la disparue lui fit retrouver son odeur et un moment il crut la voir qui se frottait à lui en riant.
Enjambant le cadre de la photo, il revit cette journée et laissa vagabonder son imagination, selon son habitude depuis qu’il était inactif. Il reconnut le gazon sur lequel le couple avait posé pour la photo et sa ferme en arrière plan. Il imagina le petit grandissant dans sa maison, entre la tendresse de sa femme et la sienne, moins démonstrative mais aussi attentive. Dans son délire il inventait des pseudos souvenirs avec des faits réels.
Le matin le trouva assoupi au pied de son lit, tout habillé, la bouteille de ratafia entre les jambes et la photo sur les genoux.
Le dénouement.
L’automne touchait à sa fin et les cèpes étaient toujours aussi abondants cette année-là. Marc connaissait maintenant les bois et les champignons. A l’occasion de ses chasses il avait eu plusieurs fois l’occasion de saluer le vieux Léon et avait remarqué son attitude ambiguë faite de curiosité ou de sollicitude indiscrète. Il avait reconnu une forme de tendresse qu’il jugeait excessive car il n’en connaissait pas la raison.
La rumeur publique lui avait appris les doutes que ses voisins avaient sur l’état mental du vieil homme, et les champignons étaient devenus pour lui une chose si passionnante qu’il ne souhaitait pas perdre du temps à prolonger ces rencontres. Un jour cependant, alors qu’il venait de remplir son panier dans un sous bois providentiel qu’il ne connaissait pas, il le vit arriver avec précaution. Ne voulant pas lui révéler par sa récolte le coin qu’il venait de découvrir, Marc cacha son panier plein sous des fougères et mit ses mains dans ses poches.
Le vieil homme, qui connaissait l’endroit depuis toujours, comprit ce que signifiait l’attitude du cueilleur sans panier. Fouillant des yeux les alentours, il vit très vite les feuilles retournées du tapis végétal qui dénonçaient la cachette. Il se balança d’un pied sur l’autre prêt à éclater d’une colère un moment contenue, puis son visage se détendit et au fur et à mesure que ses traits s’apaisaient une envie de rire le submergeait. Il marmonna entre ses dents » bougré d’asé, hier je voulais te donner ma maison et aujourd’hui tu me voles mes champignons ! « . Puis se calmant, il dit à voix haute » c’est bien pitchoun, tu as fait des progrès … » Et il partit sur un grand éclat de rire qui retentit dans la forêt bien après qu’il eut disparu sous les arbres.
Marc reprit son panier en pensant que De Gaule avait raison quand il disait que » toute vieillesse est un naufrage « .
Comment Léon devint un Tamalou (et arrêta le ratafia).
Léon sortit du couvert des arbres et, regardant le ciel, se dit que l’hiver était là. Il se demanda combien il lui restait de saisons de champignons … mais laissa la question sans réponse. Il se promit d’aller dès le lendemain s’inscrire chez les » tamalous » car cela lui occuperait l’esprit.
Il appelait ainsi les adhérents du club de troisième âge parce qu’ils se saluaient toujours par la même phrase rituelle : » et toi t’as mal où ? « .
Bernard DAVIDOU
décembre 2002