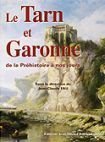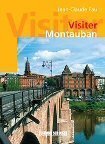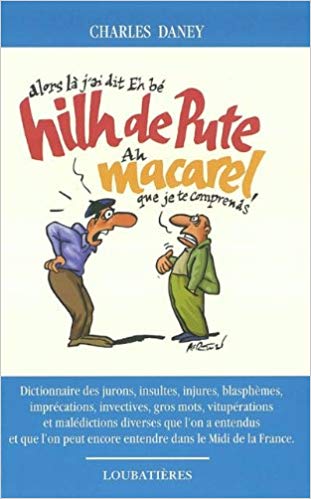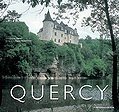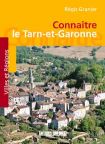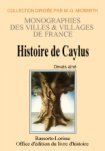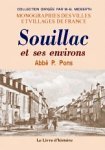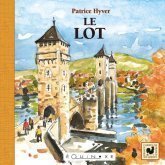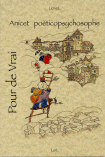» II ne fait guère de doute que les historiens de toutes sortes puiseront à foison dans cet instrument polyvalent qui offre si généreusement un matériau ordonné »
(Dominique Julia).
Fruit d ‘un dépouillement systématique de toutes les archives universitaires disponibles, ce Répertoire des étudiants du Midi de la France constituera pour bien des chercheurs modernistes un outil inégalé en France, et sans doute inégalable. P. Ferté rassemblera ici plus de 40000 étudiants méridionaux (catholiques ou protestants) des 4 facultés (droits, théologie, arts et médecine), saisis sur la plupart des campus fréquentés (Cahors, Toulouse, Avignon, Montpellier, Perpignan, Aix, Orange, Genève, et Paris pour le 18e s.) et de 1561 à la Révolution. C ‘est cette envergure pluri-universitaire qui donne tout son prix à ce corpus » insolite » (D. Julia) puisqu ‘elle seule permet d ‘aboutir à un recensement quasi-exhaustif pour chaque diocèse et chaque lieu et de calculer des taux de scolarisation supérieure. Les cursus de chacun sont reconstitués et offrent un matériau unique pour une analyse fine des stratégies éducatives et de la fonction du diplôme dans la société
d ‘Ancien Régime.
Une prosopographie est également amorcée : systématisée et enrichie par
l ‘interactivité, elle débouche sur une histoire sociale des populations étudiantes, objectif majeur des plus captivants.
Enfin, comme l ‘université était un carrefour où se côtoyaient les » héritiers » et la petite et moyenne bourgeoisie » montante « , ce sont toutes les élites de la société d ‘Ancien Régime, actuelles ou en devenir, qui sont ainsi capturées aux filets de l ‘Alma mater et dont on peut scruter, sur 2 siècles et demi, les ressorts d ‘ascension et de reproduction.
Le présent tome 2 d ‘une série de 6 embrasse l ‘ancien diocèse de Cahors, soit Factuel département du Lot, une partie du Tarn-et-Garonne et quelques communes du Lot-et-Garonne et de la Dordogne.
Le tome 1 concernait l ‘autre partie du Tarn-et-Garonne (diocèse de Montauban) et le département du Tarn (diocèses d ‘Albi, Castres et Lavaur).
Les tomes suivants se spécialiseront successivement sur les diocèses pyrénéens
et audois (t.3), sur le Rouergue (t.4), l ‘Agenais, le diocèse de Toulouse, le département actuel du Gers, etc…
Patrick Ferté est maître de conférences d ‘histoire moderne à l ‘ Université de Toulouse-Le Mirait. Spécialiste de l ‘histoire des anciennes universités méridionales, il est l ‘auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème et de maints articles scientifiques publiés en France et à l ‘étranger (Irlande, Espagne, Mexique, Canada…).